Une journée inoubliable au pays de Marie Lelandais - St Fraimbault - 15 août 2025
- guyllecture
- 10 sept. 2025
- 9 min de lecture
Dernière mise à jour : 11 sept. 2025

Tout a commencé le 18 Juillet 2025 lorsque j’ai reçu ce mail :
« Madame
Je vis à Saint Fraimbault, et je tenais à vous remercier de m’avoir fait partager la vie de Marie Landais. C'est un magnifique portrait de femme qui avait une force et une droiture incroyable pour traverser toutes ces épreuves. J'ai retrouvé ce que m'ont raconté mes parents sur la vie à Saint Fraimbault autrefois qui pouvait être belle mais aussi incroyablement dure. J'ai trouvé passionnant et instructif également votre rigueur pour nous conter la vie quotidienne de ces gens et les évènements historiques qui se sont déroulés lors de cette période.
Merci encore pour ce beau roman.
Si vous le souhaitez et si vous êtes disponibles nous serions très heureux de vous accueillir en tant qu'invite d'honneur lors de grandes fêtes des Flories D'antan le 15 Août. »

S’en sont suivies des conversations téléphoniques avec Michel LEROYER, Eric LEROUX, maire du village et Alain DELANGLE, président de CAMPACITY
Et le 15 aout je me suis retrouvée à ST FRAIMBAULT pour cette superbe fête des traditions rurales, « les Flories d’Antan »
Récit de mon escapade normande forte en émotion.
Arrivée la veille, nous avons été invités (Gilles et moi), à dîner chez Éric.
Non seulement le maire du village, mais, aussi, en cette occasion particulière, un véritable passeur de mémoire. Et pour cause, il habite à « La Lorinière », un lieu chargé d’émotion, puisque c’est là que vécut Jean Lelandais, le grand-père maternel de Marie.
Avant de passer à table, nous avons pris le temps de visiter sa ferme, guidés par l’envie de retrouver la maison d’habitation de Jean.
Jean était tisserand et les maisons typiques de tisserands telles qu’on les décrit sont à 2 niveaux.
Les métiers à tisser étaient souvent installés dans la cave, à demi enterrée, parfois tout près des tonneaux de cidre. L’humidité et la température constante évitaient ainsi au fil de casser.
Au premier étage, auquel on accédait par un escalier extérieur en pierres de dix à douze marches, se trouvait alors l’habitation principale, composée d’une ou deux pièces.
Nous n’avons pas retrouvé cette configuration telle quelle.
Le temps a effacé les contours, transformé les volumes. Pourtant, nous pensons que le bâtiment le plus ancien de la ferme pourrait bien être cette maison.

Et puis, un autre édifice m’a interpellée : un petit bâtiment, visiblement très ancien, situé juste en face. Il semblait murmurer des histoires oubliées, comme s’il avait conservé en ses murs les échos d’un métier disparu.
Peut-être abritait-il le métier à tisser… Peut-être pas.
Depuis 1790, tant de choses ont changé !
Mais ce jour-là, dans le calme de La Lorinière, le passé semblait tout proche, presque palpable.
En arpentant les lieux, j’ai constaté avec une pointe de nostalgie que tous ces chemins creux, jadis évoqués comme un véritable labyrinthe, avaient disparu.
Eric se souvenait du tracé de certains d'entre eux qui se sont effacés avec le temps, comme si la mémoire du paysage s’était doucement estompée.
Nous avons ensuite partagé un délicieux moment autour de la table familiale d’Éric et Isabelle, entourés de leurs enfants. L’ambiance était simple, généreuse, empreinte de rires et de souvenirs. Ce dîner fut un véritable instant de convivialité, riche en échanges et en émotions, où chacun semblait naturellement trouver sa place.
Un moment suspendu, comme seuls les repas partagés savent en offrir.
Le soir venu, nous avons regagné notre chambre qui se trouvait au-dessus des bureaux de la mairie, en plein cœur du village, à deux pas de l’église.

Le bâtiment, une imposante maison en pierre, fut autrefois le presbytère. Reconstruit en 1884, il témoigne de l’architecture sobre et robuste de la Troisième République, époque où les communes réaffirmaient leur identité à travers des édifices publics et religieux solidement ancrés dans le paysage.
En franchissant la grille d’entrée, on découvre un petit jardin public qui en fait le tour, paisible et verdoyant et 3 curieux petits abris en granit avec accolades qui ont peut-être servis autrefois d’oratoires.
Saint Fraimbault, ce village aux "100.000 fleurs"
Avant de revenir plus en détail sur cette journée du 15 août, je vais vous parler brièvement de Saint Fraimbault, ce village aux « 100.000 fleurs »
Saint Fraimbault doit son nom à un évangélisateur (Saint Fraimbault de Beaulieu) qui au 6e siècle ˝convertit˝ le village au christianisme.
Plus tard, à l’époque de Marie, c’était un gros bourg comptant plus de 3000 habitants.
Sa particularité était de faire partie à la fois des provinces historiques du Maine et de Normandie.Le village de Saint Fraimbault était situé pour moitié dans l’Orne et pour moitié dans la Mayenne mais a finalement était rattaché à l’Orne en 1831, bien que son église se trouvait encore sur la partie mayennaise.
Au dernier recensement (2022), il n’y a plus que 542 habitants dans ce magnifique village qui pourtant est surnommé le « village aux 100.000 fleurs »
De fait, Saint-Fraimbault est une des deux seules communes de France récompensées depuis plus de 20 ans aux concours du Grand Prix National des villes et villages fleuris.
Mais comment ce petit village dont la population décroit a-t-il réussi à obtenir ce titre prestigieux ?
Au début des années 60, trois habitantes de Saint-Fraimbault attristées par la monotonie de leur village, décidèrent de mener une véritable "guerre contre la grisaille".
Armées de fleurs et de bonne volonté, elles ont redonné des couleurs en fleurissant leurs maisons. Touché par leur initiative, le maire de l’époque lança un appel à toute la population : que chacun participe à cette métamorphose.
Avec le bénévolat et l’aide d’associations, ils se sont mis ainsi à orner les rues, les espaces et bâtiments publics. On ressortit de vieux pressoirs, de vieilles charrettes. Tout le monde se mit au travail et rapidement le bourg entier fut fleuri.
Ainsi naquit un élan collectif qui transforma le village en un véritable jardin à ciel ouvert.
En 1965, Saint Fraimbault a obtenu le 1er prix départemental des villes fleuries et sa 1ére fleur, ça ne sera que le début !

Après la distinction suprême de quatre fleurs, la commune se voit attribué le Grand Prix National de fleurissement renouvelé tous les 3 ans de 1991 à 2024.
En 1989, Saint-Fraimbault a représenté la France au niveau européen et remporté le Grand Prix Européen et a également obtenu le Trophée International de l'Entente Florale, le Prix du Bicentenaire et le Prix Spécial du Jury Départemental
Son fleurissement dépasse alors les frontières françaises. Des stagiaires japonais sont venus étudier le fleurissement frambaldéen, un jardin porte désormais le nom de la commune au "pays du soleil levant",
Cette commune est dés lors une des plus visitée dans l’Orne ; les visiteurs peuvent déambuler le long des sentiers fleuris, découvrir des jardins thématiques et profiter de l’étang communal, lieu idéal pour la détente et les activités de plein air.
Le maire nous dit que le fleurissement de Saint Fraimbault est désormais un challenge pour la commune qui permet ainsi de préserver un tissu économique et social .
Challenge pour l’instant réussi car Saint-Fraimbault, c'est bien plus qu'un village.
C'est un concentré de vie et de dynamisme comme on en voit peu ailleurs.
Telle en témoigne la journée exceptionnelle du 15 août, animée par 220 bénévoles frambaldéens.
le 15 août à Saint Fraimbault.
Ce 15 août le village entier célébrait le 30éme anniversaire des « Flories d’Antan », une fête réputée dans la région qui vise à faire revivre les traditions et le mode de vie rural d'autrefois, en mettant en valeur le patrimoine du village et les métiers oubliés.
Au petit jour de ce 15 août, déjà le village était en effervescence, tout le monde s’affairait à le transformer pour un retour dans le passé.
Et quelle surprise lorsque nous sommes sortis : tous les habitants étaient vêtus de costumes du début du XXe siècle. Même Éric, le maire, arborait fièrement une tenue traditionnelle. En un instant, nous étions transportés dans une autre époque.
Table ronde "la ruralité d'hier et d'aujourd'hui"

À 11 heures, j’avais rendez-vous à la salle polyvalente pour participer à une table ronde intitulée : « La ruralité d’hier et d’aujourd’hui, les enjeux de demain ».
Cet événement était organisé à l’initiative d'Eric Leroux, maire, en collaboration avec Alain Delangle, président fondateur de l’association Campacity.
(Campacity a pour objectif de renforcer les liens entre les territoires urbains et ruraux. À titre d’exemple, Par l'intermédiaire de Campacity, Saint-Fraimbault est jumelée avec le 18ᵉ arrondissement de Paris, illustrant parfaitement cette volonté de rapprochement entre ville et campagne.)
J’ai donc eu l’honneur d’intervenir sur la ruralité d’hier aux côtés d’élus et représentants institutionnels :
*Olivier Bitz ancien sous-préfet, sénateur de l’Orne
*Chantal Jourdan, députée de l’Orne
*Michel Dargent, maire de Céaucé
*Stéphane Lelièvre, maire de Barenton et membre du CA d’In Site
*Christian Derouet, maire de Lonlay-l’Abbaye et vice président de l’Association départementale des maires ruraux
Le débat était animé par Pierre WEILL fondateur de Bleu-Blanc-Coeur et auteur de plusieurs livres sur la santé.

La ruralité d'hier est un thème que j'aborde dans le 1er tome de la trilogie "Le Prix de vertu" en évoquant le monde paysan fin 18éme et début 19éme siècle.
J'ai choisi d’aborder la ruralité à travers trois générations : celle des grands-parents de Marie, celle de ses parents, et enfin la sienne.
J’ai commencé par évoquer Jean Lelandais, installé à la Lorinière, qui vivait sur une petite ferme héritée de sa mère. Malheureusement, il en fut spolié de manière étrange par un homme riche nommé « de Prémorel ». À partir de ce moment-là, pour faire face aux fermages qui lui étaient réclamés, il dut cumuler son activité de fermier avec celle de tisserand.
J’ai ensuite parlé des difficultés persistantes après la Révolution, en évoquant le père de Marie, qui travaillait lui aussi sur une petite ferme. Pour nourrir sa famille, il devait, tout comme son père, compléter son revenu en allant travailler dans d’autres fermes en tant que journalier.
Enfin, j’ai abordé la situation de Marie elle-même, employée comme bonne de ferme, et les maltraitances qu’elle y a subies.
Ce témoignage m’a semblé essentiel pour illustrer les conditions de vie souvent rudes dans le monde rural d’hier.
Je n’ai malheureusement pas eu le temps d’approfondir un autre sujet qui me tenait à cœur : la ferme-école fondée par les frères Louvel. Il me semblait pourtant important d’en parler, car Jacques-François Louvel était, selon moi, un véritable visionnaire. Conscient de la pauvreté qui frappait les agriculteurs du Domfrontais, il avait compris que celle-ci était en partie liée à des méthodes de travail dépassées.
Grâce à la création de cette école, de nombreux jeunes ont pu apprendre des techniques agricoles innovantes et transmettre ces savoirs à leurs parents et aux autres fermiers, contribuant ainsi à moderniser les pratiques et à améliorer les conditions de vie.
Chaque invité a ensuite pris la parole, amenant son propre témoignage et son expérience dans le monde rural d'aujourd'hui.

Repas, dédicaces et festivités
Nous étions ensuite conviés à un repas champêtre, organisé dans un cadre bucolique entre le plan d’eau et le cœur du village.
Impossible de dire combien de convives ont partagé ce moment sous les chapiteaux, mais le nombre de tables dressées était tout simplement impressionnant. Au centre, un parquet de danse attirait les regards : démonstrations, pas entraînants et musique à plein volume — parfois un peu nasillarde, parfois un peu trop forte — mais quelle ambiance !
L’énergie était communicative, les sourires nombreux, et l’atmosphère délicieusement festive.

L’après-midi, je me suis rendue au cœur du village pour une séance de dédicaces, entourée d’une joyeuse effervescence.
Les stands des producteurs et d’artisans locaux, animaient les rues avec passion, partageant leurs savoir-faire et leurs spécialités comme autant de trésors du terroir.
Le village, fermé à la circulation, laissait place à un défilé pittoresque : tracteurs anciens et leurs attelages, machines agricoles, charrettes et voitures d’époque sillonnaient les rues.

Un alambic trônait fièrement parmi les cortèges, rappelant que nous étions au cœur du pays de la goutte — ou du calva.


Les métiers oubliés reprenaient vie :
la forge résonnait du bruit du marteau,
les lavandières s’activaient au lavoir,

On redécouvrait les battages à l’ancienne, les travaux des champs, la traite des vaches à la main, et la fabrication du beurre en baratte.
Des bûcherons sciaient et débitaient des troncs, tandis qu’un peu plus loin, on assistait à la confection de cordes et à l’assemblage d’une barrière en bois.
Même le four à pain retrouvait sa chaleur d’antan.
Les animaux de la ferme attiraient les curieux. Les enfants — et les adultes, moi y compris — s’émerveillaient devant une truie entourée de ses petits. Plus loin, de jeunes veaux ne demandaient qu’à être caressés.
Les plus jeunes pouvaient même faire une balade en cariole tirée par des ânes.
Sur la place, au centre du village, des jeux en bois ravissaient petits et grands, tandis que les orgues de barbarie diffusaient tout au long de la journée des airs d’hier et d’aujourd’hui.
Des musiciens normands, passionnés de musique écossaise et irlandaise, animaient la fête avec entrain, et des accordéonistes déambulaient parmi tous les stands
Et pour couronner le tout, un match de tennis était disputé sur le court par des joueurs en costume d’époque, comme un clin d’œil sportif à ce retour dans le passé.
La soirée s’est achevée dans la douceur d’un second repas champêtre.
Vers 23h00, dès que la nuit eut posé son voile, un feu d’artifice éclatant a embrasé le ciel tandis que les visages, tournés vers les étoiles, s’illuminaient d’émerveillement, suspendus dans l’instant.

Sur le chemin du retour, baignés dans la lumière dorée des réverbères, nous avions l’étrange sensation que le passé, nous avait fait un clin d’œil.
Évoquer l’histoire de Marie Lelandais, ici même, au cœur de son village natal, dans cette atmosphère si particulière, fut pour moi un moment d’une profonde émotion.
Il y avait quelque chose de suspendu, comme si les lieux eux-mêmes murmuraient son souvenir.
Merci à tous les frambaldéens pour cette merveilleuse journée et surtout un grand merci à Michel LEROYER qui fut le premier à avoir découvert mon livre et à en avoir parlé autour de lui.
Grâce à vous, grâce à l’accueil chaleureux d’Eric et Isabelle, cette journée a pris les couleurs d’un souvenir que l’on garde longtemps dans le creux de la mémoire.
--------------------------------------------------
Vous n'avez pas encore lu la trilogie "le prix de vertu"?
Alors rendez-vous ici :
















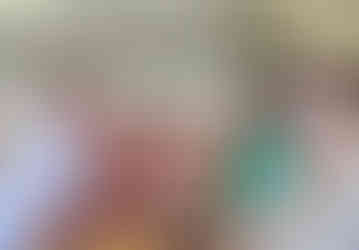




























Commentaires